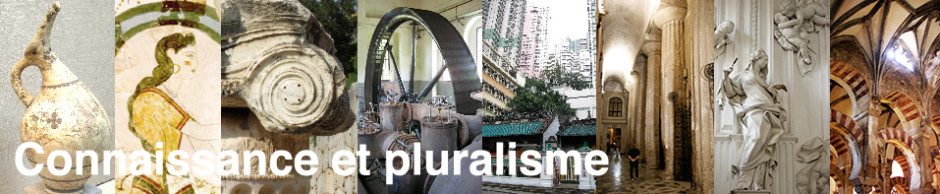Implicitement, entre les lignes, pour donner une allure constructive au discours écologiste, on laisse entendre que les écosystèmes sont capables de réagir, qu’ils ont une sorte de système immunitaire leur donnant une résilience grâce à une force de rappel qui les sauve des perturbations dommageables. Le terme d’écosystème a d’ailleurs pris ce sens de ressort-amortisseur comme une voiture est capable d’avaler les chaos. Il est employé couramment en management pour désigner les relations d’acteurs fondées sur des compétences pour la promotion d’une ressource partagée.
1/ Les humains font la guerre soi-disant pour faire la paix !
Depuis longtemps on connaissait le risque d’échauffement dû au gaz carbonique depuis l’usage intensif de charbon par la société industrielle. Mais la seconde moitié du 20ème siècle a précisé ce phénomène à trois niveaux.
• La physique a montré que l’effet sur l’atmosphère et le cycle de l’eau était chaotique : des petites causes se répandent en grands effets avec de l’aléa. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. On ne sait pas, et on ne saura pas non plus demain, ce fait fondamental a été brouillé par la presse vulgarisatrice parce que cela heurtait la philosophie de l’économie.[1]
• C’est le second point. Le non-savoir est traitée dans la pensée économique néo-classique, ou même dans l’économie dite de second rang, ou en mathématiques financières, comme des probabilités avec toute la rationalité de l’optimisation en avenir incertain. [ cf. sur ce blog les pages finance]
• A cela s’est ajouté une relativisation sociologique. Le concept clé du dilemme du prisonnier a été vu comme une des curiosités amusantes de la théorie des jeux. Et on peut rapprocher cela du fait que dans les classes sociales aisées où l’on s’attache à motiver ses enfants, on ne joue plus au jeu des sept familles mais à des jeux stratégiques qui ressemblent au vieux Monopoly avec deux ou trois étages virtuels en plus. La théorie des jeux est vue comme une bibliothèque dans le registre ludique.
Au bilan on a banalisé le problème environnemental et on a consolidé les racines égoïstes profondes du libéralisme.
Le rapport de l’ONU sur la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) fait le point en 2025 juste avant la conférence de Séville sur le financement du développement (FfD4). Contraint par la linguistique onusienne, il n’ose pas écrire que les choses empirent. Il ne cite aucun ODD se détériorant. Des 17 objectifs de développement durable 4 seulement sont en amélioration faible, et les autres sont classés parmi ceux « qui n’ont pas progressé ». C’est le cas des quatre ODD concernant directement l’environnement : ODD 11 communautés et villes soutenables; ODD 14 vie aquatique; ODD 15 vie terrestre; ODD 16 paix, justice et institutions solides
Ce rapport ne reflète pas du tout la brutalité de ce qui nous attend. On avait besoin d’un sursaut, on a une berceuse. Sur les 17 ODD les 4 seuls qui ont une pente dans la bonne direction sont : ODD 3 bonne santé; ODD 5 égalité des genres; ODD 7 énergie propre; ODD 9 industrie, innovation et infrastructures. Pourtant certains diagnostics sont clairs. Extraits :
L’Asie de l’Est et du Sud a surpassé toutes les autres régions en matière de progrès vers les ODD depuis 2015. En moyenne, à l’échelle mondiale, les ODD sont loin d’être atteints. À l’échelle mondiale, aucun des 17 objectifs n’est actuellement en voie d’être atteint d’ici 2030
Environ la moitié de la population mondiale vit dans des pays qui ne peuvent pas investir suffisamment dans le développement durable en raison du poids de la dette et du manque d’accès à des capitaux abordables et à long terme
L’architecture financière mondiale (AFM) est défaillante. L’argent afflue facilement vers les pays riches, et non vers les économies émergentes et en développement (EMDE), qui offrent un potentiel de croissance et des taux de rendement plus élevés. La première question à l’ordre du jour de la FfD4 est la nécessité de réformer l’AFM afin que les capitaux affluent en quantités bien plus importantes vers les EMDE.
2/ Les êtres vivants naturels seraient-ils protégés par la résilience des écosystèmes ?
En 1925 Jean Mascart, directeur de l’observatoire de Lyon, dans un ouvrage très approfondi reprochait à Arrhenius de croire que l’élévation de température due à l’effet de serre serait favorable à la vie des plantes et des animaux par l’humidité chaude qu’il produirait. Au contraire Mascart prévoyait l’extension des déserts et des disparitions d’espèces.[2]
La notion d’écosystème est intéressante pour faire comprendre l’importance des relations mutuelles des diverses espèces dans un cadre naturel essentiellement périodique et soumis aussi à court terme à de petites perturbations transitoires. Elle décrit le fonctionnement des chaînes trophiques et leur sensibilité à certains facteurs impactant le monde microscopique. Elle explique la second loi de l’écologie de Barry Commoner : il n’y a pas de déchets, les pourritures deviennent des aliments.[3]
Mais nulle part Commoner n’en tire l’idée que la résilience protège les écosystèmes de la brutalité humaine. La modification des conditions biotiques, chimiques, et physiques, dues à l’activité humaine, fracture les écosystèmes introduisant des failles, des fissures, qui sont traitées par les êtres vivants comme des opportunités saisies selon les fonctions de leur phénotype tel qu’il était avant la perturbation. Ainsi certaines espèce s’engouffrent dans la brèche, et se multiplient indéfiniment jusqu’à la rencontre d’un autre obstacle (cf. invasions de moustiques, de frelons, de virus, etc.).
Le principe de dire à tout le monde de freiner mais que c’est tout de même le premier arrivé qui gagne, est un piège dont les humains ne parviennent pas à s’extraire.[4] Mais ce piège opère naturellement aussi pour les plantes et les animaux. Ils ne sont pas plus sage que nous, ils sont pris dans des « capabilités » qui orientent leur vie.
3/ J’ai parlé dans mes livres du savoir de la Nature [5]
Mais il s’agit de tout autre chose. C’est une idée importante introduite déjà par Barry Commoner sous une forme différente. Elle se place à l’échelle de l’évolution et souligne que le passé des génotypes — comme trace partielle du cadre qui a été rencontré dans le passé — conditionne les mutations qui apparaissent. Ce que Commoner exprime en disant « Nature knows best ».[6]
Mais s’il est des circonstances que la nature n’a jamais rencontrées c’est bien celles dues aux humains en particulier depuis la révolution industrielle.
Donc cette « sagesse », ce « savoir » de la nature concerne la gestion des possibles et non pas les comportements vitaux liés aux fonctions nutritives et de mobilité qui sont eux mis en application dans l’instant.
4/ La spontanéité des êtres vivants aggrave les dommages artificiels introduits par l’homme.
Il ne faut pas penser l’écosystème comme un mélange d’êtres vivants interagissant dans un certain lieu et à une date donnée. C’est là que la notion de « paramètre » ou de « facteur » intervient. Il s’agit plutôt d’un système dynamique dans un espace-temps de très grande dimension. Lorsqu’il se fissure, se craquèle, se disloque, c’est mis à profit par certaines espèces qui deviennent invasives et non pas par des victoires locales mais à l’échelle de la planète propageant des problèmes et des extinctions.
Dans ce rapport, le terme écosystème n’est employé qu’une seule fois pour écourter la liste des biens communs mondiaux qu’il faudrait financer :
Les États membres des Nations unies doivent accroître leur financementdes biens communs mondiaux : la biodiversité des forêts tropicales humides, la vie marine des océans et la protection de l’atmosphère, de l’eau douce, des sols, des côtes, des zones humides et d’autres écosystèmes contre la pollution transfrontalière et la dégradation à l’échelle mondiale. Les pays à revenu élevé ont la responsabilité de remplir les fonds qu’ils ont désignés à ces fins, y compris le Fonds d’adaptation, le Fonds pour les pertes et dommages, le Fonds vert pour le climat, et d’autres encore.
L’ONU peut-elle avoir plus
d’efficacité que ces mêmes paroles toujours indéfiniment répétées ?
[1] Stephen Smale insiste : « chaos shows the weakness of models which people believed in the last century, when the future was determined by initial conditions. It shows how this breaks down at a new level, not at the macro-scale, nor on the micro-scale, but just on the everyday scale, where determinism fails. » (Mathematical Research Today and Tomorrow, Springer 1992).
[2] J. Mascart Notes sur la variabilité des climats, Audin et Cie 1925.
[3] B. Commoner The Closing Circle, Knopf 1971.
[4] N. Bouleau « Un, deux, trois soleil » Esprit déc. 2009.
[5] N. Bouleau Ce que Nature sait, La révolution combinatoire de la biologie et ses dangers PUF 2021.
[6] N. Bouleau Le hasard et l’évolution, PUF 2024.