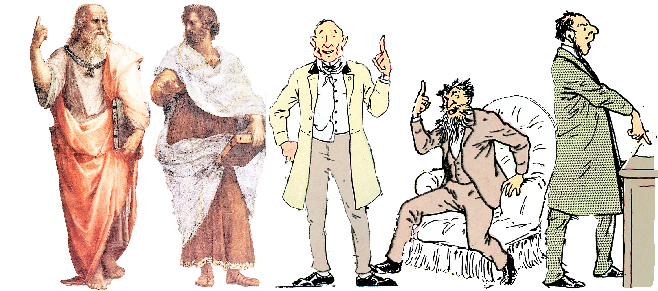 Mon essai paru aux éditions ISTE sous le titre Science nomologique et science interprétative, connaissance de l’environnement (janvier 2018) est une réflexion sur la construction du savoir qu’on appelle la science, c’est-à-dire se soumettant à une exigence de validité collective. Je donne ici un aperçu de l’argument.
Mon essai paru aux éditions ISTE sous le titre Science nomologique et science interprétative, connaissance de l’environnement (janvier 2018) est une réflexion sur la construction du savoir qu’on appelle la science, c’est-à-dire se soumettant à une exigence de validité collective. Je donne ici un aperçu de l’argument.
La thèse principale ne surprendra pas le lecteur qui fréquente de temps à autre ce blog, elle peut être résumée ainsi : Pourquoi la science serait-elle rassurante ? Comme si ce que l’on ne connaît pas devait, par nature, être bienveillant à notre égard. Cette idée tend à justifier toutes les audaces techniques sans en envisager sérieusement les conséquences. Elle cautionne des pratiques industrielles et commerciales risquées en les accompagnant de propos chimiques, physiques ou biologiques, qui ne prennent pas en compte le contexte.
Je propose de penser la connaissance comme ce qui est à transmettre, ce que l’humanité veut garder de son vécu pour les générations à venir. Dès lors, il y a aussi des préoccupations et des inquiétudes qui font partie de la science et sur lesquelles un travail scientifique est à mener.
Le positivisme n’a voulu conserver dans la science que les régularités et laisser les interprétations aux religions. Mais il a échoué car il y a en permanence de l’interprétation dans la science et c’est ce qui conditionne sa fécondité.
Nous arrivons à une période où il faut davantage d’écoute interprétative du contexte dans lequel nous vivons.
L’essai s’appuie sur quatre analyses, de registres différents, qui lui servent de soubassement : un nouveau regard épistémologique sur les mathématiques, un retour historique sur la naissance du positivisme, une discussion du concept de crise, et une réflexion sur le fonctionnement de la communauté scientifique. Puis je développe l’idée centrale que la science nomologique, c’est-à-dire fondée sur la notion de loi, n’est qu’une des deux façons de fabriquer de la connaissance, et que nous avons de plus en plus besoin de l’autre dimension du travail scientifique.
Premier volet : à partir des fondements des mathématiques. Les mathématiques sont proliférantes mais se développent sans perturber leur contexte. Si une théorie mathématique s’avère contradictoire et s’effondre, il faudra changer ses axiomes. Mais la logique elle-même est cohérente et complète, c’est une structure « inoxydable » en quelque sorte. Cette ontologie où ce qui se passe en interne n’a d’autres répercussions qu’en interne, est exceptionnelle. Les mathématiques nous font croire qu’on peut créer, fabriquer du nouveau sans perturber le cadre. C’est leur mauvais enseignement. Hegel disait que la nouveauté détruit. Ce n’est pas vrai en mathématiques. En revanche, la chimie prolifère en jetant des molécules sans qu’on sache ce qu’elles deviendront, et les sciences humaines perturbent le cadre social dans lequel elles émergent. Pour ce qui est de la physique, comme toutes les sciences dont la théorie est mathématisée, la totalité de son développement déductif nous semble innocent parce que mathématique, contenu dans ce qui est déjà admis. Pourtant il porte en lui la suggestion de nouvelles expériences, de nouveaux instruments et dispositifs, au delà de ceux qui ont fait accepter cette théorisation.
Les mathématiques ne font pas peur. Elles n’apportent que des cadeaux finalement. Seulement la pureté inoffensive des mathématiques est souvent utilisée de façon idéologique pour faire croire à l’innocence de procédures très engagées dans la perturbation du monde.
Second volet : limites et persistance du positivisme. Des divers grands récits sociaux qui naissent au 19ème siècle c’est le positivisme qui fonde les bases de la rationalité scientifique et reste aujourd’hui la référence majeure, avec ses deux versants celui d’Auguste Comte à visée descriptive et celui de John Stuart Mill de référence utilitariste. Si ces deux penseurs sont d’accord sur la loi des trois états de la connaissance qui écarte de la science positive les causes premières et les fins ultimes, et sur la notion de loi pour définir la scientificité, le premier n’est pas parvenu à donner corps à l’ancrage de sa doctrine dans le social par la religion des grands hommes, et son influence – considérable – ne s’est fait sentir qu’à l’intérieur des disciplines scientifiques. En revanche les vues du second, fondées sur l’appel à la diversité des idées et la liberté de contredire, furent relayée par le courant du pragmatisme puis par les théoriciens de l’économie libérale de sorte qu’elle est devenue une doctrine géante qui réussit si bien qu’elle empêche de voir les questions qui sont hors du champ où elle a été conçue.
Dans la seconde moitié du 20ème siècle les épistémologues ont commencé à se rendre compte de l’importance de l’interprétation dans la fabrication de connaissance et les penseurs ont prêté une attention nouvelle à l’impact de la technique sur l’environnement. Mais une autre transformation concomitante eut un effet plus direct sur la pratique scientifique. A un rythme surprenant se sont développées l’informatique et la modélisation qui ont bouleversé les méthodes, et activé certaines disciplines au détriment d’autres. Le positivisme n’a pas été écarté, il prit une forme plus élaborée.
Il ne s’agit plus tellement aujourd’hui de dégager des lois au sens de Comte, c’est-à-dire d’induire à partir de mesures l’existence d’une fonction mathématique qui rende compte d’une régularité. Les moyens de calcul permettent de faire beaucoup mieux, une fois dégagées les dépendances multiples d’un phénomène à diverses grandeurs, il est possible de trouver les valeurs des paramètres qui donnent le résultat le meilleur pour tel ou tel usage, c’est l’optimisation. Une part considérable du travail scientifique aujourd’hui consiste à optimiser. En économie et en finance bien sûr, mais aussi dans les sciences de l’environnement. Les algorithmes numériques permettent de trouver la solution de plus grande « utilité » dans des cas compliqués, en présence d’aléa, etc. Optimisation, contrôle optimal, pilotage de la nature, telle est la forme que prend le positivisme aujourd’hui.
Il se passe alors exactement ce qui se passait un siècle auparavant : on passait sous silence le choix interprétatif que représente l’hypothèse, on omet aujourd’hui de voir la modélisation comme une interprétation parmi d’autres possibles, comme un parti de représentation qui, loin d’être induit spontanément par la situation, résulte d’une compréhension, d’une lecture de la réalité et s’inscrit dans une pluralité. En acceptant « pour la commodité » le saut épistémique de prendre le modèle pour ce qu’il représente, puis en le faisant accoucher de stratégies optimales, on fige la pensée dans une vision actuelle, simplifiée, fermée, parce qu’on refuse le jeu de l’interprétation multiple qui résulterait de la considération de modélisations diverses ouvertes à d’autres visions du réel.
Troisième volet : le concept de crise permet de préserver le positivisme. Parmi les systèmes épistémologiques qui furent proposés au 20ème siècle qui prirent la physique comme cas générique, la vision de Thomas Kuhn est particulièrement éclairante. Il montre que la connaissance s’y fait selon des périodes « normales » où la plasticité des notions-clés est suffisantes pour s’adapter aux nouveautés rencontrées et les agréger, périodes ponctuées de « révolutions » au cours desquelles le corpus est remanié et de nouveaux « paradigmes » sont adoptés mieux acceptés eu égard aux mesures effectuées et aux représentations mathématiques considérées comme prometteuses.
Parallèlement l’économie a banalisé la notion de crise. Selon un regard historique, l’économie réelle, vécue, est jalonnée d’un grand nombre de crises, faillites de grande ampleur, perte de confiance dans la monnaie, etc., dont le parangon est la crise de 1929 aux conséquences géopolitiques majeures. La théorie économique a proposé des explications et des justifications de la présence de crises. Elles peuvent être comprises par des anticipations collectives récursives (bulles spéculatives) et des conflits d’interprétations. Selon nombre d’auteurs, elles doivent être considérées comme salutaires pour rétablir des liens directs entre les productions et les valeurs, et pour faire place à des innovations.
L’économie et la physique sont deux domaines différents, mais ils irradient incontestablement l’un sur toutes les sciences de la nature, l’autre sur toutes les sciences sociales (bon gré mal gré). Ainsi nous voyons aujourd’hui bien installée cette conception de la connaissance qui progresse par à coups, comme des plaques tectoniques.
Le schème conceptuel est très simple. Compte tenu des connaissances disponibles, des théories et des données recueillies, la fécondité propre des disciplines, due aux questions qui s’y posent naturellement, étend et élargit le savoir en tenant compte de l’expérience, la nouveauté étant interprétée grâce aux langages et aux concepts en vigueur. Mais ce faisant, parce que la science pratiquée est essentiellement déductive, nous progressons sur l’espace des conséquences de nos hypothèses, et, insensiblement, nous quittons la réalité.
Entre les révolutions, c’est-à-dire dans les périodes où la communauté scientifique, en tant qu’institution, fonctionne « bien », le positivisme règne. Et en économie la pensée néoclassique reste la référence. Ce canevas est maintenant pris comme habit épistémologique général. On admet que les développements internes et les crises sont la dialectique propre à la connaissance. Un peu chaotique mais nécessaire.
En dehors des crises, le positivisme est le maître. La méthode des essais-erreurs est légitimée comme une évidence et employée tout azimut, sans restriction aucune, et les transformations du monde qu’elle déclenche ou induit, sont pensées comme innocentes, puisque conformes à l’empirisme positiviste. Le positivisme a conquis le sens commun. Non seulement les scientifiques mais les hommes politiques, les grands médias, et même les juristes, pensent selon le schéma primaire que vivre c’est essayer, et qu’essayer c’est vivre. Comme si maman-nature allait de toute façon réparer les dégâts.
Evidemment si des à coups sont nécessaire dans le développement de la science c’est qu’elle n’intègre pas clairement l’interprétation dans le procès ordinaire de la construction de connaissance. Le socle positiviste, qui est la référence la plus généralement partagée par les scientifiques, limite la science à une trop petite partie de nos moyens de connaître. Les dommages faits au cadre de vie des humains et des êtres naturels, et les perspectives alarmantes que l’on est obligé de penser, demandent d’intégrer le processus interprétatif au sein même du travail scientifique.
Vient maintenant l’époque où nous devons reconnaître qu’il n’y a aucune raison que ce que nous ne connaissons pas soit réconfortant.
Quatrième volet : changements dans la communauté scientifique. Le thème de la connaissance et de l’intérêt, souligné par Habermas, est un entre-deux qui peut être affiné et discuté sous des regards philosophiques et politiques variés, avec les concepts-outils de modernité, de partage nature-culture, de performativité, etc. Mais il me semble qu’on n’a pas suffisamment attiré l’attention sur une grande mutation qui est en cours dans la communauté scientifique.
Vers le milieu du 20ème siècle la prise de conscience que la science perturbe le monde était surtout le fait de penseurs de forte personnalité, engagés, qui alertaient le public sur les questions de la technique, de finitude de la planète et des flux, puis pour certains, avec les moyens de la sociologie des sciences. Mais maintenant la situation n’est plus du tout la même. Les trente glorieuses sont loin. La dynamique typique qu’elles représentaient et qu’il convenait absolument d’infléchir pour sauver l’environnement n’est plus là. La croissance est faible, les inégalités augmentent. La société est engluée malgré elle dans un business as usual dont elle ne parvient pas à sortir par le seul jeu de la puissance internationale du libéralisme économique.
La faiblesse de cet ordre mondial pour répondre à des objectifs collectifs consensuels est maintenant flagrante. Très contraignant économiquement par certaines institutions phares comme les marchés financiers, ce système économique n’a pas le rôle de régulateur qu’on attendrait aujourd’hui d’une mondialisation. Et dans cette situation, présentement très embrouillée, les scientifiques sont devenus véritablement le « parti du contexte et du long terme ». Ils sont la catégorie sociale la plus sensible aux biens communs, la plus tournée vers la défense de la biodiversité, la plus réticente aux solutions artificielles d’hyper-productivité.
Ils sont d’ailleurs obligés de prendre au sérieux ces inquiétudes. Certes on ne peut les accuser d’imprévoyance en matière de changement climatique, puisqu’ils sont à l’origine de l’IPCC. Mais si telle ou telle catastrophe sanitaire, tels ou tels désastres irréversibles se produisent, les politiques comme d’habitude n’y seront pour rien. Je pense que nos institutions présentes sont largement inadaptées aux perspectives qui s’annoncent pour la planète, annoncées schématiquement par le rapport Meadows. Mais dans cette inquiétante routine, la communauté des scientifiques trouve un nouveau fondement à son discours, non plus en sonnant les trompettes du bonheur par le progrès – mais en assumant plus sérieusement que les autres les inquiétudes qu’elle est à même de comprendre.
L’essai approfondit en conclusion la pensée de Jonas en la rendant concrète et opérationnelle. Je montre que c’est un travail typiquement scientifique en partant de craintes intéressées, locales, d’élaborer des craintes désintéressées.
La science a jusqu’à présent fortement privilégié les élaborations déductives. L’accent a été mis sur le mécanisme de l’induction pour sa vertu de questionnement du monde à partir d’une structure logique. Soit sous la forme de l’extension d’une régularité, au cœur de la doctrine positiviste, soit à partir d’une théorie charpentée et mathématisée selon la conception de Karl Popper.
Aussi la pratique scientifique des deux derniers siècles a-t-elle, sinon négligé, du moins considéré comme secondaire l’opération elle-même de découverte de la régularité ou de la théorie, opération de nature interprétative, volontiers laissée aux commentateurs de la science, psychologues ou historiens.
Mais au delà de la découverte de l’accrochage au réel d’une déduction possible, on s’aperçoit que c’est toute la dimension interprétative de la construction de connaissance dont on s’est détourné.
Dès lors, si on se convainc, à partir des analyses de Thomas Kuhn sur la physique et à partir de l’examen du fonctionnement des sciences humaines aussi bien que des mathématiques, que l’interprétation est un moteur de la connaissance au moins aussi indispensable que la déduction, cette négligence demande une explication à la hauteur des enjeux considérables de ce débat. On peut en trouver l’origine dans le partage de territoire historique entre la science et la religion. Le début de la période « moderne » se trouve alors moins caractérisé par la séparation homme-nature comme il a été souvent dit, que par le rejet du talent interprétatif hors des outils de connaissance parce qu’il apparaissait de la même veine que ce qui fabriquait l’animisme et l’idolâtrie.
La prise de conscience plus aiguë des problèmes environnementaux à la fin du 20ème siècle nous oblige cependant d’aller bien au delà des idées de Kuhn, qui finalement conserve une vision positiviste, où l’interprétation n’intervient vraiment que sous la forme de révolutions, complexes et irrationnelles, imprévisibles comme les crises en économie, périodes brèves où est concentré tout le questionnement ontologique de la connaissance.
Pour penser la science selon une acception plus large qui permette une prise en compte des êtres-questions et des alertes, ainsi que tendent à le faire de plus en plus de chercheurs sur l’environnement aujourd’hui, il faut reconstruire une vision philosophique en amont des limitations positivistes. Ceci peut se faire en considérant la science comme ce qui est à transmettre. Or le processus de transmission, pédagogique et historique, n’utilise pas uniquement des dispositifs déductifs, il est aussi l’énonciation et le passage de craintes. L’apprenti ne copie pas seulement les gestes, l’analytique en quelque sorte, il s’imprègne aussi des craintes du compagnon expérimenté.
La permanence historique des préoccupations était souvent dans le passé la fonction des divinités secondaires et locales, comme le cas des lacs-maars le montre si clairement.
Nous arrivons ainsi à une conception de la connaissance où la déduction n’a plus une place si privilégiée, et où l’on voit plus nettement ses abus et ses impasses pour penser l’éventuel.
La croyance à une bienveillance providentielle de ce que nous ne connaissons pas est, à l’origine, un transfert du religieux vers la science. Aujourd’hui, en revanche, c’est le libéralisme économique qui veut accaparer la fabrication de connaissance, et il la tire vers le rassurant et le réconfortant pour des raisons tout à fait différentes qui tiennent à la nécessité de donner bonne figure à l’innovation technique pour que l’engouement ainsi souligné apporte les moyens financiers des investigations. Nous voyons donc que la réintroduction de l’interprétation et des craintes dans la déontologie licite de la science heurte de plein fouet la logique strictement économique.
En revanche le travail scientifique pour transformer une crainte subjective et inscrite dans les particularités du social en une crainte désintéressée, devient pleinement légitime et apparaît la meilleure façon pour l’humanité de penser son cadre de vie. Ce travail, que j’ai esquissé dans le cas d’un être-question, souvent ne tranche pas quant à l’existence de l’être supposé mais avance néanmoins en le cernant davantage et transmet une préoccupation qui est notre meilleure façon d’entendre le contexte de notre humanité.
Pourquoi insisté-je sur la relation entre l’interprétation et les craintes ? La psychanalyse nous suggère fortement ce lien. Mais nous parlons d’épistémologie et le passage du psychique au social est toujours trop rapide. Pourquoi ne pas insister sur les espoirs plutôt que sur les soucis ? L’espérance n’est-elle pas aussi créatrice d’interprétation ?
Simplement parce que nous sommes martelés, battus comme du fer à forger, avec les espoirs en tout genre que proclament la publicité et la propagande pour faire consommer les artéfacts et pour encourager leur production. Cette avalanche de promesses de bonheur, de suggestion de visions de jouissance, à ceux qui piétinent dans un quotidien morne et répétitif, est une civilisation à bout de course. Et cela vient empiéter sur ce que devrait être le domaine du savoir. Les craintes désintéressées sont des entités parfaitement respectables, bien autant que des lois scientifiques putatives. Le trou d’ozone, la mort des abeilles, la raréfaction des poissons, la pollution des nappes aquifères, sont les objets sur lesquels l’humanité a à construire une connaissance, c’est-à-dire une structure de pensée qui tienne la route dans le registre de l’intérêt collectif.
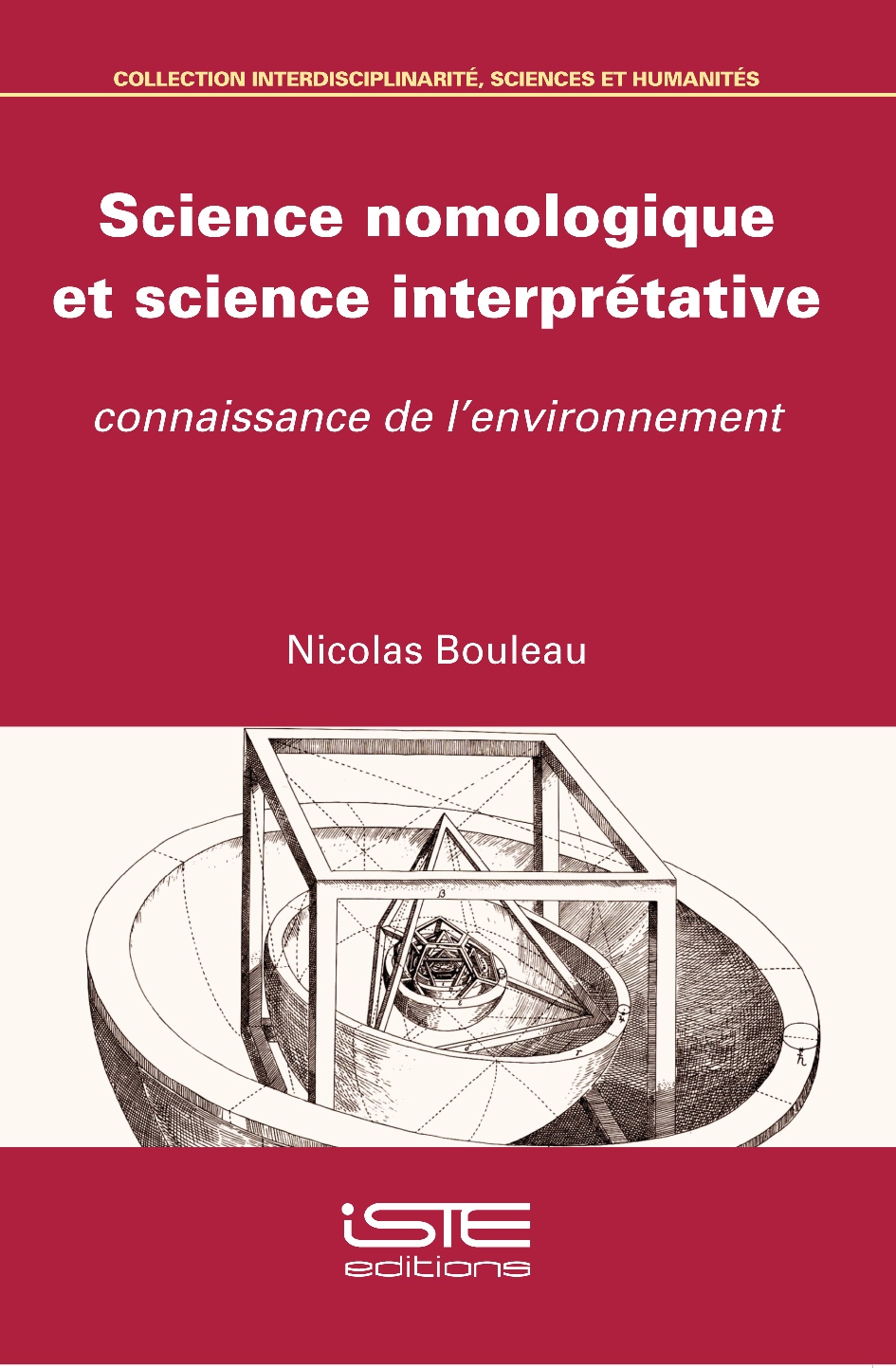 L’ouvrage Science nomologique et science interprétative, connaissance de l’environnement.
L’ouvrage Science nomologique et science interprétative, connaissance de l’environnement.
est disponible aux éditions ISTE .
